Le secret professionnel et le secret médical
Les professionnels de la santé doivent être conscients et surtout vigilants de leur responsabilité envers la confidentialité, car toute violation de ce secret peut avoir des conséquences graves tant sur le plan éthique que juridique.
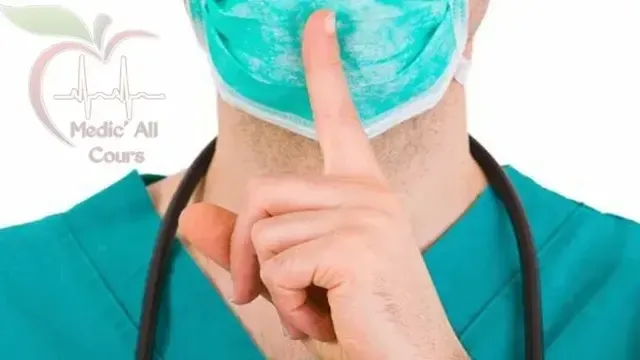 |
| Secret médical, législation, éthique, déontologie |
I- Définitions de la législation, l'éthique et la déontologie
1. La législation
La législation englobe l'ensemble
des règlements et des lois en vigueur dans un pays. C'est l'ensemble des règles
juridiques qui régissent les droits, les devoirs et les comportements au sein
d'une société.
La législation est élaborée par
des organes compétents, tels que les parlements ou les assemblées législatives et elle peut varier d'un pays à l'autre. Elle joue un rôle crucial dans le
maintien de l'ordre public et la protection des droits individuels et
collectifs.
2. L'éthique
L'éthique est la science de la morale et des comportements. Cette discipline philosophique se penche sur les finalités de l'existence, les valeurs, les conditions de vie ainsi que sur des questions morales.
3. La déontologie
La déontologie se réfère à
l'ensemble des règles et devoirs qui régissent la conduite des membres d'une
profession ou des personnes occupant une fonction dans la société.
II- Le secret professionnel et le secret médical
Le secret professionnel est
fondamental dans la relation de soin : sans confiance, il n’y a pas de soins,
et sans secret, il n’y a pas de confiance.
1. Définitions
1-1. La confidentialité
« Chacun a droit au respect de sa vie privée. » (Article 9 du Code Civil).
C’est le caractère qu’on réserve à
une maladie ou à un traitement ou à une information, dont l’accès est limité
seulement aux personnes admises à le (la) connaitre.
1-2. Le secret professionnel
Moins large que la confidentialité, il s'agit d'un devoir imposé aux
professionnels de conserver secrètes toutes les informations confidentielles
obtenues dans l'exercice de leur activité.
Ce secret couvre tout ce que le professionnel a pu entendre, voir, lire ou apprendre dans le cadre de son activité, incluant les informations médicales et personnelles.
1-3. Le secret médical
Encore plus restreint que les deux notions précédentes. Il désigne l'obligation de tout professionnel de santé de garantir et de protéger la confidentialité de toutes les informations concernant la santé de leurs patients. Il est essentiel à la relation de confiance entre le patient et le soignant.
Ce secret ne s'applique pas uniquement aux données médicales, mais englobe également toute information personnelle liée à la vie privée du patient.
Le non-respect de cette obligation
peut entraîner des conséquences légales pour le professionnel de la santé.
1-4. La discrétion professionnelle
Elle est différente du secret professionnel. Elle s'applique aux
fonctionnaires, y compris les infirmiers, qui doivent faire preuve de
discrétion concernant les faits et informations obtenus dans le cadre de leurs
fonctions (Article 26 de la loi n°83-34 du 13 juillet 1983 sur les droits et
obligations des fonctionnaires).
1-5. L'obligation de réserve
C’est une obligation qui limite l'expression des fonctionnaires,
interdisant les critiques publiques des services publics, bien que des
critiques puissent être formulées dans certaines situations.
1-6. Le secret partagé
Un professionnel de santé peut partager des informations secrètes avec un autre
collègue, à condition d'avoir obtenu l'autorisation du patient.
2. Les obligations légales du secret professionnel et médical
Article L 1110-4 CSP : « Le secret est un droit du patient, lié à l’intimité de sa vie privée. » Toute personne prise en charge par un
professionnel de santé a le droit au respect de sa vie privée ainsi qu'à la
protection de toutes les informations la concernant.
Article R 4312-5 CSP : Pour les infirmiers, « le secret professionnel s'impose à tout infirmier,
dans les conditions établies par la loi. »
Certaines exceptions légales
existent, comme pour les déclarations de naissances, décès, maladies
contagieuses, admissions en psychiatrie, accidents de travail et alertes
sanitaires.
III- Le consentement du patient
Le consentement du patient pour les soins médicaux est aujourd'hui encadré par la législation.
 |
| Secret médical, législation, éthique, déontologie : consentement du patient |
1. Définition du consentement du patient
Article L
1111-2 du Code de Santé Publique : Lorsque, suite à des investigations, de
nouveaux risques sont découverts, la personne concernée doit en être informée,
sauf si elle est injoignable. Cette responsabilité incombe à tous les
professionnels de santé, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité d'informer.
Le patient doit être informé afin
de pouvoir donner un consentement libre et éclairé, sauf dans certaines
situations d'urgence ou si le patient préfère ne pas être informé.
2. Le rôle de l’infirmier vis à vis du consentement du patient
Il incombe à chaque professionnel de santé d'informer le patient. Toutefois, seul le médecin peut communiquer un diagnostic. L'infirmier doit s'assurer que l'information a bien été transmise, souvent lors d'entretiens individuels.
Le consentement doit être recueilli avant toute intervention, sauf si le patient est dans l'incapacité de consentir.
Les informations fournies doivent être loyales et honnêtes, garantissant que le patient reçoit la vérité, sauf s'il manifeste le désir de ne pas être informé. Elles doivent être transmises dans un langage compréhensible et approprié.
Enfin, le personnel soignant doit apporter l’aide nécessaire à son patient dans le cadre de sa prise de décision en rapport avec son consentement.
Conclusion
En conclusion, le secret médical assure la totale protection des informations médicales mais aussi personnelles des patients, renforçant ainsi la confiance nécessaire à la relation soignant-soigné.
En respectant le secret médical,
le professionnel de la santé contribue à garantir une prise en charge de
qualité d’une part, ainsi que le droit du patient à une vie privée
confidentielle.
